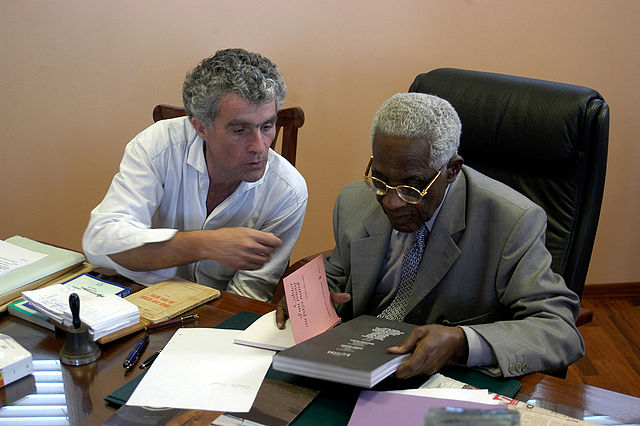Né sous l’influence du mouvement indigéniste haïtien de Jean-Price Mars, le mouvement de la Négritude s’impose comme une résistance culturelle à l’impérialisme occidental. Porté par Césaire, Senghor et Damas, il devient une révolution intellectuelle panafricaine célébrant les valeurs, la sensibilité et l’identité du monde noir.
Un mouvement littéraire et politique panafricain
Selon l’universitaire Ama Mazama, professeure à l’Université Temple de Philadelphie, la Négritude « est née de la résistance à l’assimilation et à l’aliénation coloniale ». Forgé par Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal (1939), le concept s’affirme aux côtés de Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas comme une réponse poétique et politique à l’ordre colonial français.
Le mouvement s’inspire du mouvement indigéniste haïtien conduit par Jean-Price Mars, qui plaidait pour la valorisation des traditions africaines face à l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934). Il entre également en dialogue avec la Harlem Renaissance et le panafricanisme d’Edward Wilmot Blyden, cherchant à redéfinir « l’African personality ».
La Négritude fut profondément panafricaine, réunissant de nombreux écrivains issus du monde noir : Jacques Rabémananjara (Madagascar), Jacques Roumain (Haïti), Étienne Léro (Martinique), Paul Niger et Guy Tirolien (Guadeloupe), David Diop (Sénégal), entre autres. Leurs œuvres furent rassemblées par Senghor dans son célèbre recueil Anthologie de la poésie nègre et malgache de langue française (1969).

Une philosophie poétique de l’être africain
Pour Senghor, la Négritude constitue « la somme des valeurs culturelles du monde noir ». Elle exprime « une certaine manière d’être homme », fondée sur la communauté, l’émotion et la spiritualité. À l’opposé du rationalisme occidental, cette pensée érige la sensibilité et le rythme en principes d’existence.
Césaire, dans son Cahier d’un retour au pays natal, donne une portée cosmique à cette quête identitaire :
« Ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour…
Ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale,
Elle plonge dans la chair rouge du sol,
Elle plonge dans la chair ardente du ciel. »
Ces vers expriment une reconnexion charnelle et spirituelle à la terre africaine, refusant toute fossilisation de l’identité noire. Ils traduisent une négritude vivante, en mouvement, puisant sa force dans la nature et la mémoire des peuples.
Les salons littéraires de Paulette et Jane Nardal à Paris, ainsi que la revue Présence Africaine fondée par Alioune Diop, ont largement contribué à diffuser cette pensée dans le monde francophone.
Entre contradictions et héritage universel
Malgré son ambition émancipatrice, la Négritude comportait des ambiguïtés. Senghor et Césaire, tout en glorifiant la culture africaine, demeuraient attachés à la langue et à la culture françaises. Senghor ira jusqu’à proposer une « civilisation de l’universel », fondée sur la fusion des cultures, mais cette idée, selon Ama Mazama, « risquait de maintenir la dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Europe ».
Les critiques ont aussi questionné l’existence d’une essence noire ou la cohérence politique des auteurs, notamment l’adhésion de Senghor au modèle néocolonial français. Néanmoins, la Négritude a marqué un tournant majeur dans la conscience culturelle et politique du monde noir, inspirant des générations d’écrivains, d’artistes et d’intellectuels africains et caribéens.
À lire aussi :
Burkina Faso : Ibrahim Traoré accueille Franklin Nyamsi à Ouagadougou